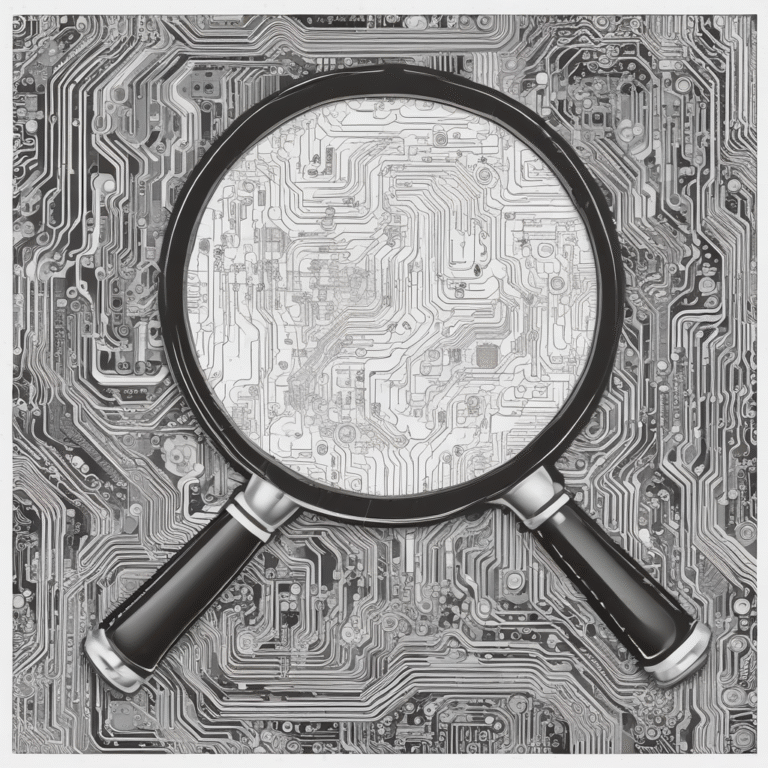Réguler l’IA selon les termes de l’Amérique latine
L’Amérique latine doit faire un choix crucial qui déterminera son avenir économique : développer une gouvernance de l’IA selon ses propres termes, ou devenir une colonie réglementaire de Silicon Valley et de Bruxelles.
A travers la région, les décideurs politiques prennent conscience que l’IA n’est pas une simple mode technologique, mais un changement structurel rapide qui affecte déjà l’emploi, les services publics et les processus démocratiques. Des exemples récents, comme des audio synthétiques imitant des figures politiques qui ont circulé durant les élections municipales de Buenos Aires, illustrent cette réalité. Au Brésil, le gouvernement a eu des conflits avec Meta concernant la transparence algorithmique. Parallèlement, les systèmes éducatifs intègrent discrètement des outils d’IA dans les salles de classe, souvent sans supervision ni directives.
Les chiffres racontent une histoire préoccupante : selon un récent indice du FMI, l’Amérique latine accuse un retard par rapport aux pays développés et à la Chine en matière de préparation à l’IA dans quatre domaines clés : infrastructure numérique, capital humain et politiques du marché du travail, innovation et intégration économique, et réglementation. Si elle est bien pensée et opportune, la réglementation peut non seulement limiter les risques associés à l’IA, mais aussi renforcer la confiance du public, attirer des investissements responsables et protéger les petits innovateurs contre les géants de la technologie.
Une fenêtre d’opportunité étroite
L’Amérique latine dispose d’une fenêtre d’opportunité étroite pour façonner des règles à la fois protectrices et habilitantes, qui reflètent ses propres valeurs et sa réalité. Les pays dotés de cadres réglementaires clairs, comme le Royaume-Uni en matière de technologie financière et de cybersécurité, tendent à attirer plus d’investissement et d’innovation. Le modèle de gouvernance numérique de l’Estonie a attiré des milliards de dollars d’investissements technologiques. A l’inverse, les pays sans cadres réglementaires risquent de devenir des terrains de dumping pour des systèmes d’IA non testés.
Pour l’Amérique latine, une réglementation intelligente de l’IA—qui équilibre protection et innovation, s’adapte rapidement et reflète les réalités sociales et institutionnelles locales—implique également de positionner la région comme une destination privilégiée pour les investissements responsables en IA, à un moment où d’autres régions sont soit trop strictes soit trop laxistes. L’Amérique latine ne devrait pas simplement copier d’autres modèles ou repartir de zéro, mais élaborer ses propres réglementations en matière d’IA, en s’inspirant de modèles mondiaux mais en les adaptant aux besoins et valeurs locaux.
Ce qui se passe dans la région
L’Agenda numérique 2024 de la CEPAL, approuvé par les 33 pays membres, appelle à une coordination régionale, à des normes partagées et à un renforcement des capacités transfrontalières. Cependant, le paysage réglementaire à travers l’Amérique latine reste fragmenté, chaque pays étant à différents stades de développement.
Le projet de loi du Brésil, inspiré de l’Acte de l’UE sur l’IA, est le cadre le plus développé de la région, comprenant des dispositions sur la responsabilité civile et des catégories de risque échelonnées. Le Chili a élaboré une législation axée sur la transparence, l’équité et le contrôle humain, s’appuyant sur sa politique nationale en matière d’IA. La Colombie, le Perou et le Paraguay travaillent sur des propositions axées sur la protection des données, l’équité algorithmique et l’utilisation éthique dans des secteurs comme l’éducation et la finance. L’Argentine n’a pas de loi formelle, mais une dynamique se crée : des auditions récentes au Congrès ont mis en lumière des questions telles que la manipulation électorale et la confidentialité des données.
Construire un cadre intelligent
Dans un récent document à l’intention des législateurs de l’Amérique latine, il est proposé un outil simple pour éviter le piège de la copie des modèles étrangers, organisé autour de l’objectif, du risque, de l’approche et du contexte.
Avant d’adopter toute réglementation sur l’IA, les décideurs doivent pouvoir répondre clairement à quatre questions clés :
- Quel est l’objectif de la réglementation ? Protéger les droits, promouvoir l’innovation ou sécuriser les intérêts nationaux ? Les règles de l’IA en Chine privilégient la sécurité de l’État, la Charte des droits de l’IA aux États-Unis se concentre sur les libertés civiles, et le cadre du Royaume-Uni vise à favoriser l’innovation tout en protégeant la sécurité publique.
- Quels systèmes d’IA nécessitent un niveau de surveillance plus élevé ? Un assistant de planification IA présente des risques différents d’un agent de prêt IA. Un cadre basé sur le risque se concentre sur la surveillance là où le préjudice est le plus probable.
- Le cadre doit-il se concentrer sur des lignes directrices éthiques de haut niveau, des normes techniques détaillées ou des “salles de sable” flexibles ? Les approches contrastées de Singapour, du Canada et de la Corée du Sud illustrent ces différentes méthodes.
- Quel contexte local doit être pris en compte ? Ce qui fonctionne dans un pays riche et très numérisé peut échouer dans une région où le travail informel est courant et l’infrastructure numérique inégale.
Une approche réglementaire pour l’Amérique latine
Les pays de la région n’ont pas besoin de repartir de zéro, mais ils ne devraient pas non plus se contenter de copier les cadres internationaux. L’Amérique latine devrait développer sa propre approche réglementaire, avec un accent sur la flexibilité, l’inclusion, la coordination régionale et le renforcement des capacités.
Étant donné le rythme du changement en matière d’IA, la réglementation doit évoluer rapidement. Les programmes pilotes et les salles de sable réglementaires peuvent offrir un terrain d’expérimentation pour l’adaptation. Les systèmes d’IA formés sur des données en langue anglaise ou du Nord global manquent souvent de tenir compte des réalités latino-américaines.
Une réglementation fragmentée invite à l’arbitrage réglementaire (les entreprises cherchant la juridiction la plus permissive). Des normes de données partagées et des organes de gouvernance conjoints pourraient donner à l’Amérique latine une voix collective plus forte sur la scène mondiale.
De nombreux gouvernements manquent encore des équipes techniques nécessaires pour auditer, évaluer ou faire respecter les règles sur l’IA. Des investissements dans l’alphabétisation en IA, en particulier parmi les fonctionnaires, sont essentiels. Un programme de formation régional pourrait construire ces capacités de manière efficace tout en créant des réseaux pour une coordination continue.
Pour y parvenir, une direction prometteuse serait de lancer des laboratoires de surveillance de l’IA avec des universités afin de permettre aux chercheurs locaux d’étudier l’IA dans son contexte. Une autre option serait de créer des salles de sable régionales où les startups reçoivent des retours en temps réel des régulateurs tout en développant de nouveaux outils.
Ces étapes stratégiques peuvent aider à positionner la région pour attirer des investissements en IA éthique et protéger les institutions démocratiques, tout en évitant les dynamiques extractives de l’économie numérique où les données et la valeur sont concentrées entre les mains de quelques-uns, au détriment des utilisateurs, des travailleurs et de l’innovation locale.
Une opportunité de leadership
L’IA évolue rapidement, mais l’Amérique latine ne doit pas jouer à rattraper. En apprenant d’autres régions et en adaptant ses approches à son propre contexte, la région peut façonner une gouvernance de l’IA qui soit inclusive, réaliste et à l’épreuve du futur.
Plutôt que de se contenter de suivre, l’Amérique latine a l’opportunité de diriger en construisant un écosystème de réglementation qui soit flexible, conscient du contexte et ancré dans les priorités de développement.
Les 18 mois à venir sont critiques. Le paysage réglementaire mondial se polarise rapidement, créant une opportunité sans précédent pour l’Amérique latine de définir sa propre approche.
Au début de 2025, les États-Unis ont pris un tournant décisif vers la déréglementation lorsque le président Trump a émis des ordres exécutifs révoquant des directives antérieures axées sur la sécurité, et dirigeant les agences fédérales à privilégier l’innovation, la sécurité nationale et la compétitivité économique plutôt que la surveillance préventive. Ce changement crée un contrepoids net à l’Acte sur l’IA de l’Europe, de plus en plus restrictif, approfondissant une division réglementaire qui pourrait fragmenter la gouvernance mondiale de l’IA.
La plupart des initiatives internationales sur l’IA, des principes de l’OCDE au Processus de Hiroshima du G7, qui a produit des engagements larges mais sans obligations contraignantes, restent volontaires et aspirantes, manquant de mécanismes d’application susceptibles de combler ces divisions croissantes. Cette polarisation renforce l’importance des cadres régionaux : ils offrent un chemin pour innover localement tout en coordonnant collectivement.
Dans ce contexte, l’Amérique latine peut définir une troisième voie, en élaborant une réglementation sur l’IA qui évolue chaque trimestre plutôt qu’annuellement, priorise la transparence plutôt que la restriction, et construit des capacités régionales plutôt que de compter sur l’expertise étrangère.
Une réglementation intelligente de l’IA en Amérique latine signalerait qu’elle peut gouverner l’innovation sans l’étouffer et protéger ses citoyens tout en les préparant à l’avenir.