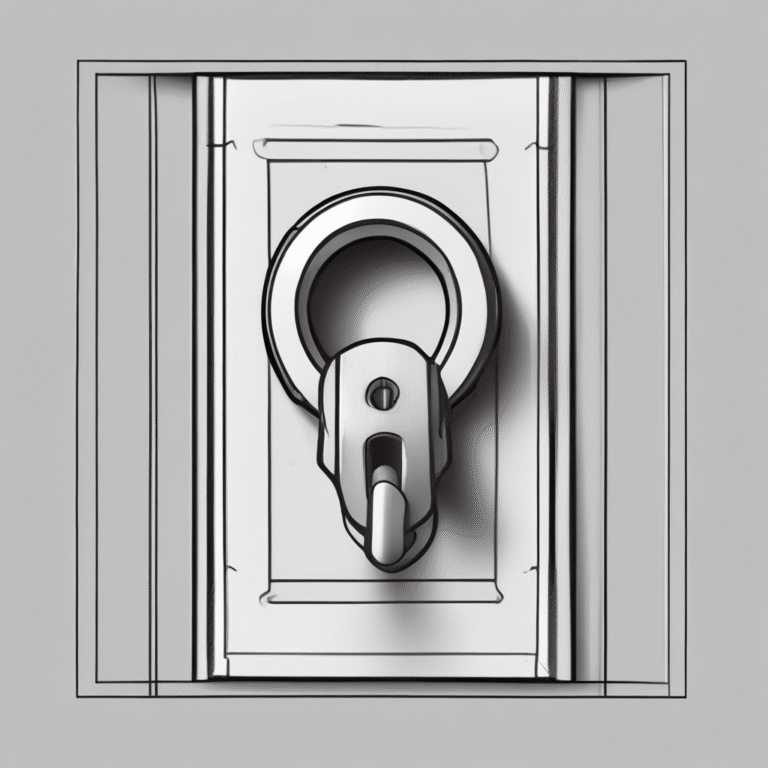Pourquoi l’infrastructure et la gouvernance de l’IA doivent évoluer ensemble
L’infrastructure de l’intelligence artificielle (IA) évolue plus rapidement que la réglementation nécessaire pour la gouverner. Les modèles d’IA, avec leur empreinte physique croissante, de la puissance de calcul à la gestion thermique, posent des défis majeurs à la fois pour l’environnement et la société.
Les défis de l’IA
Le déploiement rapide des technologies d’IA transforme tout, des infrastructures de données à la gouvernance mondiale. Bien que l’IA offre des avantages significatifs – comme l’amélioration de l’efficacité et l’optimisation de la gestion de l’énergie – son expansion soulève des préoccupations concernant la consommation d’énergie et d’eau, les déchets électroniques et la dépendance à des ressources non renouvelables.
Le paradoxe de Jevons suggère que les gains d’efficacité pourraient paradoxalement augmenter la consommation globale de ressources à mesure que l’utilisation de l’IA augmente. En parallèle, les cadres de gouvernance – allant du droit environnemental à la réglementation numérique – peinent à suivre le rythme des évolutions rapides de l’infrastructure d’IA.
Cette dynamique influence de plus en plus les décisions dans les domaines de la politique, des affaires et des investissements en infrastructure.
Une convergence sous-explorée
Malgré leur séparation apparente, les domaines de l’infrastructure et de la gouvernance numérique convergent. Cette convergence est cependant sous-explorée dans le discours public. La numérisation actuelle révèle trois disparités critiques :
- Disparités fonctionnelles : Des silos se forment entre l’infrastructure d’IA, la durabilité environnementale et d’autres domaines comme la finance.
- Disparités spatiales : Une coordination insuffisante entre les niveaux de gouvernance locaux, nationaux et internationaux.
- Disparités temporelles : Un décalage entre les cycles de déploiement rapide des systèmes d’IA et les besoins à long terme de résilience environnementale et sociétale.
Pour remédier à ces disparités, une vision holistique est nécessaire, où le développement de l’infrastructure et la gouvernance évoluent de concert. Ceci est particulièrement critique pour la région Asie-Pacifique, où la densité urbaine, la vulnérabilité climatique et la numérisation accélérée se croisent.
Exemples de bonnes pratiques
Les efforts de Singapour illustrent cette approche intégrée, avec des initiatives telles que la Feuille de route pour les centres de données verts et le Cadre de gouvernance de l’IA pour l’IA générative, visant à aligner les cadres d’infrastructure et de gouvernance pour faire avancer des écosystèmes numériques durables.
Le changement d’infrastructure
Le développement de l’IA augmente la demande d’infrastructures numériques avancées, en particulier des centres de données. Ce système fait face à des stress à plusieurs niveaux, notamment sur les réseaux électriques et la gestion des déchets électroniques.
Le refroidissement par air atteint ses limites thermodynamiques. Avec des densités de racks projetées atteignant jusqu’à 600 kilowatts, les systèmes de refroidissement traditionnels ne peuvent plus gérer les charges thermiques intenses des matériels d’IA de nouvelle génération. La transition vers des technologies de refroidissement liquide et hybride est essentielle, bien qu’elle pose de nouveaux défis opérationnels.
Évaluation environnementale
Une évaluation environnementale complète de l’infrastructure d’IA devrait inclure les émissions de portée 1, 2 et 3, conformément au Protocole des gaz à effet de serre, englobant l’utilisation de l’énergie, le carbone incorporé dans la fabrication et les impacts matériels en fin de vie.
Le décalage réglementaire
Les cadres réglementaires peinent à suivre le rythme des évolutions rapides de l’infrastructure et des systèmes d’IA. Sans gestion proactive, les risques de :
- Régimes de conformité réglementaire fragmentés à travers les juridictions.
- Arbitrage réglementaire, favorisant des environnements à normes inférieures.
- Rapports de durabilité incohérents ou incomplets.
Pour gérer cela efficacement, des normes de durabilité claires et interopérables pour l’infrastructure d’IA sont nécessaires, soutenant les évaluations d’impact environnemental et la cohérence réglementaire transfrontalière.
Un processus coopératif
Atteindre une IA durable nécessite une action intégrée des gouvernements, des acteurs de l’industrie, des institutions académiques et de la communauté au sens large. À l’échelle mondiale, des cadres coopératifs visant à intégrer la durabilité au cœur du développement de l’IA émergent progressivement.
En Europe, la Loi sur l’IA de l’Union Européenne de 2024 impose aux fournisseurs de modèles d’IA de documenter leur consommation d’énergie, marquant un premier pas vers la responsabilité environnementale du secteur.
Pour réussir, la région Asie-Pacifique doit se concentrer sur plusieurs domaines clés : la réalisation d’évaluations d’impact sur l’ensemble du cycle de vie, la gestion de la complexité de l’infrastructure, l’amélioration de la transparence dans l’utilisation des ressources, la stimulation de l’innovation réglementaire et l’avancement de la normalisation transfrontalière.
En liant le développement de l’infrastructure à la responsabilité environnementale, la région peut devenir un modèle pour des écosystèmes d’IA intégrés et tournés vers l’avenir.