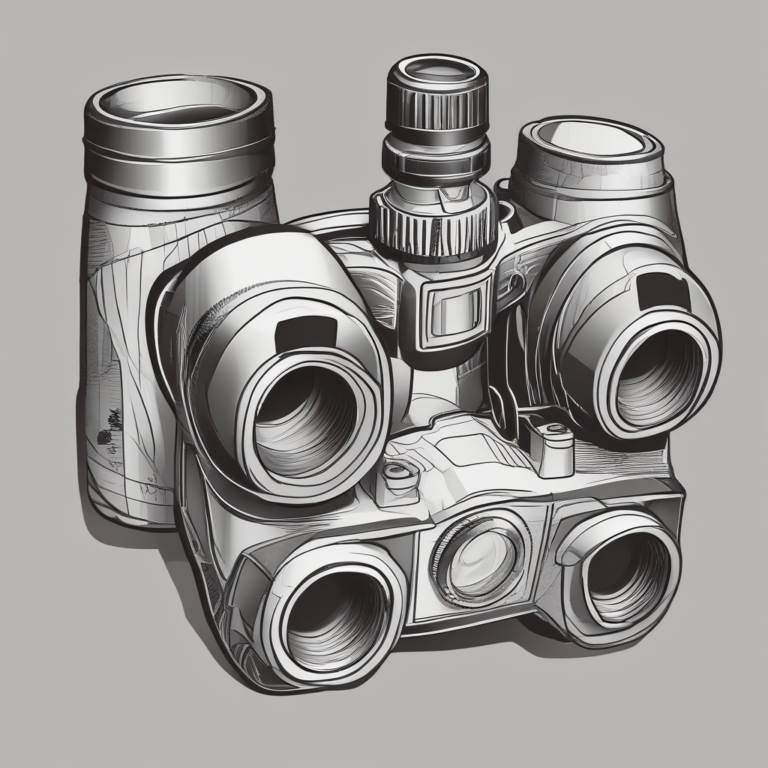Lex Algorithmi, Lex Imperfecta? Les limites de la traduction juridique dans le règlement européen sur l’IA
Il est bien connu que la technologie et le droit ne progressent pas toujours à la même vitesse. Cependant, l’intelligence artificielle (IA), et en particulier les systèmes de prise de décision algorithmique, introduisent une complexité supplémentaire dans cette équation. Ces systèmes sont de nature sociotechnique; ils ne se contentent pas de traiter des données, ils codifient des normes sociales, des hypothèses politiques, des règles institutionnelles, et parfois même des biais involontaires. Ainsi, lorsque le droit essaie d’intervenir, il ne s’agit pas simplement de réglementer du code ; il s’agit de naviguer à travers des valeurs, des structures et des systèmes de pouvoir.
Dans la théorie juridique, il existe un terme pour le défi de transformer de grandes idées en lois concrètes : translatio iuris — la traduction des principes en règles exécutoires. Le règlement européen sur l’IA, salué comme un mouvement législatif majeur, constitue une étude de cas parfaite de la difficulté de cette traduction. Il est une chose de dire que nous voulons une IA digne de confiance, des systèmes non discriminatoires, et un design centré sur l’humain, mais il en est une autre de définir ce que cela signifie réellement en matière d’audits de systèmes, de transparence algorithmique, ou de conformité transfrontalière.
Le fossé de traduction
En lisant le règlement européen sur l’IA, ou des cadres plus larges comme les Principes de l’IA de l’OCDE ou les directives éthiques de l’UNESCO, il est facile d’être impressionné par l’ambition. Des mots comme transparence, équité, responsabilité, et non-manipulation apparaissent fréquemment. Mais que signifient-ils réellement lorsque les ingénieurs s’asseyent pour construire un modèle, ou lorsque les régulateurs doivent décider si un outil d’IA franchit une limite légale?
C’est ici que l’idée de translatio iuris devient centrale. Les idéaux éthiques de haut niveau doivent être convertis en mécanismes opérationnels, techniques, et légalement exécutables. La difficulté réside dans le fait que les systèmes d’IA ne se contentent pas de faire des choses ; ils structurent des décisions. Ils filtrent, recommandent, classent et prédisent. Ce faisant, ils redéfinissent les contextes mêmes que les lois visent à réguler.
Du Ex Ante au Ex Post
Le droit ne concerne pas seulement le contenu, mais aussi le timing. Les systèmes juridiques régulent souvent par un mélange de exigences ex ante (avant le fait) et de remèdes ex post (après le fait). Cette structure est particulièrement importante dans la gouvernance de l’IA, où les risques peuvent être probabilistes, opaques, ou seulement visibles après déploiement. Le règlement européen sur l’IA suit cette architecture réglementaire classique.
A. Ex Ante
Ces exigences sont de nature préventive. L’idée est d’anticiper le dommage avant qu’il ne se produise en intégrant des garanties dans le processus de conception, de développement et de déploiement. Cela inclut :
- classification des risques selon le Titre III du règlement ;
- gouvernance des données (Art. 10) ;
- obligations de transparence (Art. 13) ;
- mécanismes de supervision humaine (Art. 14) ;
- évaluations de conformité et marquage CE (Art. 19–20).
Ces obligations agissent comme des filtres, garantissant que seuls les systèmes qui répondent à des seuils prédéfinis entrent sur le marché. Ils reflètent le principe de lex specialis — des règles ciblées qui prévalent sur des règles plus générales (lex generalis) dans des contextes à haut risque.
B. Ex Post
Une fois qu’un système est opérationnel, un autre ensemble de mécanismes entre en jeu — audits, suivi des performances dans le monde réel, gestion des plaintes, et actions d’application. Ceux-ci sont conçus pour :
- Détecter les dommages ou violations légales manqués lors du développement
- Permettre un recours et une correction (par exemple, les pouvoirs d’application de l’Article 71)
- Mettre à jour les classifications de risque en fonction de l’utilisation réelle et de l’évolution du contexte
Cependant, comme l’ont noté des chercheurs sur la responsabilité algorithmique, la régulation ex post peine lorsque la chaîne décisionnelle est non linéaire ou probabiliste. Même si un utilisateur est lésé par une décision d’IA, retracer la cause ou la partie responsable peut s’avérer extrêmement difficile.
Gouverner à l’ère de la dérive algorithmique
Alors que les législateurs essaient de canaliser des technologies en évolution rapide dans des catégories stables, nous assistons à quelque chose de plus dynamique qu’un simple rattrapage réglementaire. Ce qui est en jeu, c’est de savoir si les systèmes juridiques peuvent rester intelligibles et autoritaires dans un paysage défini par la fluidité, l’abstraction, et la délégation.
Cela ne concerne pas seulement la régulation, mais aussi l’épistémologie. Les systèmes d’IA brouillent les lignes entre action et délégation, entre acteur et outil. Ils produisent des décisions qui, en théorie, sont traçables, mais en pratique, souvent trop complexes, trop opaques, ou trop émergentes pour une attribution facile.
En fin de compte, la leçon la plus importante n’est pas de savoir quelle maxime latine invoquer ou quel trou dans la réglementation combler. C’est la nécessité d’une gouvernance réflexive, des règles qui ne sont pas seulement exécutables, mais contestables. Des mécanismes qui facilitent le défi, l’explication, ou l’adaptation des décisions au fil du temps.