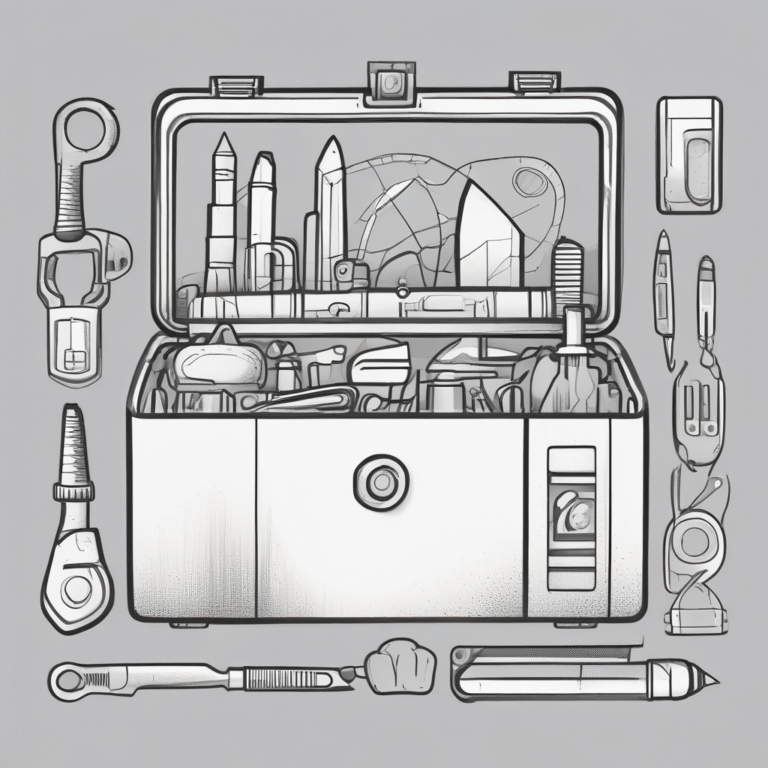5 façons dont les coopératives peuvent façonner l’avenir de l’IA
Actuellement, le développement de l’IA est contrôlé par un petit groupe d’entreprises. Des sociétés comme OpenAI, Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft dominent grâce à des ressources informatiques vastes, des ensembles de données propriétaires massifs, une main-d’œuvre technique importante, ainsi que des pratiques d’extraction de données et des coûts de main-d’œuvre réduits. Même les challengers open-source comme DeepSeek s’appuient sur une puissance de calcul considérable.
Cette domination engendre des problèmes tels que des violations de la vie privée, des stratégies de réduction des coûts de main-d’œuvre, des coûts environnementaux élevés dus aux centres de données, et des biais évidents dans les modèles qui peuvent renforcer la discrimination dans des domaines tels que l’embauche, la santé, le crédit et le maintien de l’ordre. Ces problèmes touchent souvent les personnes déjà marginalisées. Les algorithmes opaques de l’IA ne contournent pas seulement le contrôle démocratique et la transparence, mais influencent également qui est entendu, qui est surveillé et qui est discrètement écarté.
Cependant, alors que les entreprises envisagent d’utiliser cette technologie, il peut sembler qu’il y ait peu d’autres options. Il semble donc qu’elles soient enfermées dans ces compromis.
Un modèle différent est cependant en train de prendre forme, bien que discrètement, mais avec un potentiel réel. Les coopératives d’IA—des organisations développant ou gouvernant des technologies d’IA sur la base de principes coopératifs—offrent une alternative prometteuse. Le mouvement coopératif, avec son empreinte mondiale et sa diversité de modèles, a réussi dans des domaines allant de la banque et de l’agriculture à l’assurance et à la fabrication. Les entreprises coopératives, qui sont possédées et gouvernées par leurs membres, ont longtemps géré des infrastructures pour le bien public.
Un petit nombre de coopératives d’IA offrent des exemples préliminaires sur la manière dont la gouvernance démocratique et la propriété partagée pourraient façonner des utilisations de la technologie plus responsables et centrées sur la communauté. La plupart d’entre elles sont de grandes coopératives agricoles qui mettent en œuvre l’IA dans leurs opérations quotidiennes, telles que le programme DRONAI d’IFFCO (IA pour la fertilisation), FrieslandCampina (contrôle de la qualité des produits laitiers) et Fonterra (analyse de la production de lait). Les coopératives doivent s’organiser en urgence pour contester la domination de l’IA ou rester sur la touche des développements politiques et technologiques critiques.
Il y a indéniablement un potentiel ici, tant pour les coopératives existantes que pour les entreprises qui pourraient vouloir s’associer avec elles. La chute de 589 milliards de dollars de la capitalisation boursière de Nvidia, provoquée par DeepSeek, montre à quelle vitesse l’innovation open-source peut modifier le paysage. Mais pour que les laboratoires coopératifs d’IA fassent plus que signaler une intention, ils ont besoin d’infrastructures publiques, de partenariats civiques et d’un soutien sérieux.
Ce que les coopératives peuvent faire
Les coopératives ont longtemps géré des systèmes complexes pour le bien commun, allant de l’électrification rurale à l’énergie renouvelable, et ont prouvé qu’elles sont des alternatives viables au contrôle monopolistique. Dans le monde entier, les coopératives emploient environ 280 millions de personnes, soit 10 % de la main-d’œuvre mondiale. En général, elles suivent sept principes fondamentaux qui traduisent des valeurs démocratiques en pratiques commerciales : adhésion volontaire, contrôle démocratique, participation des membres, autonomie, éducation, coopération et préoccupation pour la communauté. Ces principes remontent à 28 tisserands du milieu du XIXe siècle en Angleterre, les Pionniers équitables de Rochdale, qui ont ouvert un petit magasin vendant de l’avoine, de la farine et du beurre—et ont discrètement semé un mouvement mondial.
Dans La coopérative d’intelligence artificielle, Melissa Terras et ses collègues montrent que l’application véritable des principes d’infrastructure coopérative à l’IA peut conduire à des résultats plus équitables.
L’adhésion volontaire et ouverte élargirait considérablement le cercle des parties prenantes ayant un véritable mot à dire dans le développement et l’utilisation de l’IA.
Le contrôle démocratique des membres pourrait contester la gouvernance descendante de l’IA. Cela signifierait donner aux personnes qui l’utilisent—et dont les moyens de subsistance sont susceptibles d’être affectés—plus de pouvoir pour décider de la manière dont elle est conçue, de ce qu’elle fait, et des données qui sont collectées, comment elles sont stockées, et à qui, le cas échéant, elles sont vendues.
La participation économique des membres garantit que les bénéfices sont réinvestis dans le système, plutôt que d’être extraits par des investisseurs.
L’autonomie et l’indépendance permettent aux coopératives de servir leurs communautés sans ingérence.
L’éducation, la formation et l’information sont centrales aux principes coopératifs. Les systèmes IA opaques enracinent l’inégalité, laissant les communautés impuissantes face aux décisions algorithmiques, et la transparence de l’IA s’arrête souvent à rendre les systèmes techniquement explicables. Mais la véritable responsabilité nécessite d’équiper les individus avec la connaissance nécessaire pour contester et remodeler ces systèmes.
La coopération entre coopératives favorise le progrès partagé. Tout comme les coopératives traditionnelles se renforcent mutuellement par la collaboration, les coopératives d’IA pourraient créer des couches de données partagées, garantissant que les ressources restent communes plutôt que privatisées. La plupart des cadres éthiques de l’IA mettent l’accent sur l’équité, la transparence et la responsabilité, mais peu abordent la solidarité—un vide que l’IA coopérative peut combler.
Enfin, la préoccupation pour la communauté insiste pour que l’IA soit conçue pour le bien commun. Cela signifie aligner le développement avec la durabilité, le service public et le bien-être—et non pas seulement au bénéfice des membres ou des retours pour les investisseurs.
Cinq interventions pour façonner l’avenir de l’IA
En travaillant avec ces principes, les coopératives peuvent façonner l’avenir de l’IA de cinq manières clés : démocratiser la gouvernance des données, relier la recherche, la société civile et la politique, faire avancer l’éducation, construire des modèles de propriété alternatifs, et s’adapter de manière critique à l’IA pour des fins coopératives.
Démocratiser la gouvernance des données.
Les coopératives d’IA sont encore petites et émergentes, mais celles qui existent donnent un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler une infrastructure de données et une gouvernance différentes—et comment elles peuvent changer la manière dont les données sont contrôlées et accessibles. MIDATA est une coopérative de données de santé à but non lucratif suisse qui place les citoyens fermement aux commandes de leurs propres informations médicales. Les membres ouvrent un compte de données sécurisé et crypté et peuvent accorder sélectivement aux chercheurs l’accès à leurs données personnelles, tout en gouvernant la coopérative démocratiquement par le biais de son assemblée générale.
D’autres coopératives de données notables incluent Pescadata, une coopérative de données mexicaine aidant les pêcheurs à petite échelle à gérer et bénéficier de leurs enregistrements de captures ; et SalusCoop, une coopérative de données de santé citoyenne espagnole plaidant pour une gouvernance participative des données.
Des centres de données coopératifs—comme ceux gérés par GAD eG, l’épine dorsale informatique de longue date du secteur bancaire coopératif en Allemagne—ancrent davantage ces efforts en offrant une infrastructure gouvernée par et responsable envers leurs institutions membres. Et aux États-Unis, les coopératives électriques utilisent l’IA pour la gestion du réseau et la maintenance prédictive, améliorant la fiabilité du service sans développer de nouveaux systèmes d’IA.
Relier la recherche à la société civile.
La plupart des discussions critiques sur l’IA se déroulent dans des silos d’élite—conférences académiques, groupes de réflexion, laboratoires financés par des capitaux-risque. Mais les décisions prises là ont des conséquences quotidiennes. Le mouvement coopératif est particulièrement bien placé pour socialiser ces débats, amenant l’IA dans les mairies, les centres communautaires et les assemblées citoyennes. Les coopératives peuvent aider à ancrer l’innovation dans les besoins des communautés plutôt que dans les marchés.
Encore une fois, des efforts précoces suggèrent la possibilité. Considérons des groupes comme Code for Africa, qui construit une technologie civique à travers le continent ; l’Institut pour l’Économie Numérique Coopérative, un centre de recherche à The New School axé sur les coopératives de plateforme et la gouvernance numérique ; et l’Aapti Institute à Bangalore, axé sur les données équitables et les droits numériques, qui mettent déjà ces idées en pratique.
Faire avancer l’éducation.
Combler l’écart de connaissances en IA ne consiste pas seulement à traduire—il s’agit de pouvoir. L’Alliance Coopérative Internationale—l’organisation de premier plan représentant le milliard de personnes engagées dans les coopératives à l’échelle mondiale—pourrait jouer un rôle de leader en utilisant l’IA pour l’éducation coopérative à l’échelle mondiale. Les coopératives peuvent créer des plateformes d’apprentissage en IA multilingues et audio, offrant une formation professionnelle à leurs membres.
Construire des modèles de propriété alternatifs.
La propriété façonne la direction. OpenAI a commencé comme une organisation à but non lucratif « pour l’humanité », puis a évolué vers un modèle à profit limité pour attirer des capitaux-risque—un mouvement qui était autant idéologique que légal. Les coopératives, en revanche, utilisent des réserves indivisibles et une gouvernance démocratique pour rester alignées sur un objectif à long terme. Des coopératives riches en ressources comme IFFCO (5,5 milliards de dollars de revenus annuels en 2023) et Amul (9,5 milliards de dollars) pourraient tester l’IA dans l’agriculture et les systèmes alimentaires ; Rabobank (14 milliards de dollars), Crédit Agricole (46 milliards de dollars) et Desjardins (17 milliards de dollars) pourraient mener dans le domaine financier, en pilotant une IA éthique pour le scoring de crédit, la détection des fraudes et les services aux membres. De plus, Amul a commencé à utiliser des publicités générées par l’IA sur ses plateformes numériques.
S’adapter de manière critique à l’IA pour des fins coopératives.
Toute l’IA n’est pas naturellement adaptée aux modèles coopératifs. Mais là où elle l’est—coopératives de plateforme, communs de données, outils de gouvernance—il y a de la place pour construire. Le défi consiste à redesign l’IA elle-même, pas simplement à « utiliser l’IA mieux ». Cela signifie investir dans l’infrastructure, les cadres juridiques et les formes organisationnelles qui garantissent la responsabilité dès le départ. Le fait de sous-traiter l’IA aux grandes entreprises technologiques n’est pas une stratégie—cela crée des dépendances. Les coopératives ont besoin de leurs propres pipelines : pour le développement, l’expérimentation et le déploiement. Et pour les coopératives de travailleurs comme pour les grandes coopératives de consommateurs, l’IA offre une opportunité de ramener les membres à l’intérieur—non pas en tant qu’utilisateurs passifs, mais en tant que participants actifs.
Bien que l’IA soit commercialisée comme libérant les travailleurs des tâches routinières, elle restructure souvent les rôles de manière à affaiblir la négociation collective et à faire baisser les salaires—surtout pour les étiqueteurs de données et les modérateurs de contenu dans le Sud Global. Que se passerait-il si ces travailleurs n’étaient pas seulement des contractants, mais des parties prenantes dans les systèmes qu’ils aident à construire ? La coopérative de travailleurs de la technologie Gamayyar au Kenya vient de se lancer et espère offrir une véritable alternative au modèle extractif qui domine une grande partie de l’économie numérique. En éliminant les intermédiaires et en donnant aux travailleurs un accès direct à des clients mondiaux, la coopérative assure une compensation équitable, des paiements rapides et une propriété partagée de la plateforme elle-même. Sa gouvernance démocratique et ses systèmes de soutien professionnel—du réseautage aux ressources en santé mentale—démontrent comment les travailleurs technologiques peuvent passer de contractants fragmentés à parties prenantes qui façonnent l’avenir de leur travail.
Un modèle pour ce qui est possible
READ-COOP, une coopérative savante gérant des outils d’IA pour des documents historiques, est une preuve de concept convaincante. Fondée en 2019 avec 10,6 millions d’euros de financement de l’UE dans le cadre du programme Horizon 2020, elle a évolué d’un projet académique financé par des subventions à une coopérative d’IA transnationale auto-suffisante. Structurée en tant que Société Coopérative Européenne (SCE), READ-COOP gouverne Transkribus, une plateforme d’apprentissage automatique pour la reconnaissance de texte manuscrit et la transcription de documents.
Transkribus a traité plus de 90 millions d’images historiques et continue de croître. Elle permet aux utilisateurs—des historiens professionnels et archivistes aux lycéens et groupes communautaires—de numériser, rechercher, annoter et traduire des documents manuscrits dans plus de 200 langues et dialectes. Ses modèles ne sont pas seulement façonnés par des développeurs, mais par les personnes qui les utilisent—les membres téléchargent des données, affinent des algorithmes et votent sur les priorités de la plateforme—démocratisant l’accès à l’IA en permettant aux utilisateurs quotidiens de former et de diriger eux-mêmes les outils.
Contrairement à la plupart des plateformes commerciales, Transkribus ne monétise pas les données des utilisateurs ni n’érige de murs payants autour de ses fonctionnalités les plus précieuses. Tous les calculs sont exécutés à partir de 100 % d’énergie renouvelable via TIWAG, renforçant les engagements environnementaux de READ-COOP. La plateforme est gouvernée par une coopérative avec 227 organisations membres dans 30 pays—y compris des universités, des archives nationales, des gouvernements municipaux et des groupes de patrimoine culturel.
Transkribus est plus qu’un produit—elle fonctionne comme une infrastructure publique. Gouvernée par ses membres, qui votent sur les prix, les fonctionnalités et les politiques éthiques, elle s’aligne sur des priorités académiques et culturelles plutôt que commerciales. Au-delà de sa plateforme centrale, READ-COOP soutient des programmes d’alphabétisation, s’associe à des bibliothèques rurales et aide les communautés à transcrire des langues menacées et à récupérer des histoires perdues—étendant l’IA dans le domaine de la préservation culturelle et de la mémoire démocratique.
Cependant, elle reste largement sous le radar. Mais elle offre un modèle prometteur : une infrastructure d’IA coopérative qui pourrait se développer dans des secteurs particuliers, se maintenir avec le soutien de financements de subventions, et opérer au-delà des frontières—tout en restant éthique, responsable et orientée vers l’intérêt public. La question n’est pas de savoir si c’est possible, mais où cela a le plus de potentiel—et si nous choisirons de le soutenir avant que l’opportunité ne se rétrécisse.
Barrières à l’échelle
L’IA favorise l’échelle, et les coopératives manquent d’accès au capital, à la puissance de calcul et aux forums politiques d’élite dans un marché de plus en plus verrouillé. Former un modèle à grande échelle comme GPT-4 nécessite non seulement du talent, mais aussi une infrastructure massive et des données propriétaires—des actifs que la plupart des coopératives n’ont pas. En conséquence, même les coopératives bien intentionnées deviennent souvent dépendantes des API corporatives, renforçant ainsi les structures qu’elles visent à résister.
Internement, les coopératives rencontrent également des défis : prise de décision lente, hésitation technologique, littératie limitée en IA, et lacunes en leadership. À mesure qu’elles grandissent, certaines dérivent vers des hiérarchies traditionnelles—se coop-washant dans le processus. D’autres choisissent l’inaction, submergées par la rapidité des changements.
Les coopératives doivent non seulement sécuriser un financement dédié, des infrastructures publiques et une représentation politique pour éviter d’être mises de côté dans un système déjà biaisé contre elles, mais elles doivent également cultiver une action collective enracinée à la fois dans la rigueur intellectuelle et la stratégie pratique. Cela signifie s’engager dans une recherche approfondie et un apprentissage partagé pour affiner notre compréhension de l’économie coopérative, tout en développant simultanément des plans d’implémentation détaillés, des modèles de gouvernance, et des campagnes de plaidoyer qui traduisent les principes en résultats tangibles. Sans cet engagement dual envers une analyse réfléchie et une organisation concrète, même les initiatives bien intentionnées risquent de rester une rhétorique souhaitable plutôt que de conduire à un changement systémique réel.
Construire un large mouvement
Si les coopératives ne s’engagent pas dans le développement et le déploiement de l’IA, elles risquent non seulement l’irrélevance mais de devenir des structures de soutien pour les systèmes mêmes qu’elles étaient censées contester. L’IA n’est pas neutre. Elle détermine comment le travail est organisé, comment l’information circule, et qui a accès aux outils qui façonnent l’avenir. Pour que les coopératives aient de l’influence, elles ne peuvent pas opérer isolément. Elles doivent construire des réseaux, partager des infrastructures et s’associer à des mouvements sociaux plus larges—syndicats, groupes pour la justice climatique, coalitions pour les droits numériques, campagnes pour la souveraineté des données des peuples autochtones.
Pourtant, beaucoup hésitent, même si les coopératives sont conçues pour naviguer dans les contradictions et perdurer—s’étendant des idéologies de la gauche radicale à la droite libertaire et du scepticisme environnemental au féminisme grassroots—unies non par un consensus politique mais par un engagement commun envers la propriété collective et le contrôle démocratique. À quoi ressemblerait l’engagement en pratique ? Les coopératives de travailleurs technologiques pourraient-elles s’aligner avec des syndicats comme le Syndicat des Travailleurs d’Alphabet, lancer des fonds de défense juridique pour protéger les données des utilisateurs contre l’extraction, ou développer des modèles de gouvernance partagée pour contrebalancer le pouvoir des entreprises dans la régulation de l’IA ? Ce ne sont pas des questions hypothétiques, mais les premiers mouvements d’un projet bien plus vaste.
L’IA n’est pas seulement un saut technologique—c’est une réinitialisation systémique, qui définira comment les institutions fonctionnent et qui elles servent. Les expériences coopératives qui se déroulent aujourd’hui ne s’échelonneront pas du jour au lendemain. Les coopératives ne pourront pas dépasser Big Tech en termes de dépenses. Mais par le biais de principes alignés, de coordination mondiale et de partenariats concrets dans les secteurs public et privé, elles peuvent aider à remodeler le paysage. Mais elles posent un défi qu’il vaut la peine de prendre en compte : que les structures de propriété, de gouvernance et de responsabilité comptent non seulement pour l’équité—mais pour la stabilité à long terme. Les innovations les plus précieuses pourraient ne pas provenir des modèles les plus rapides, mais des systèmes les plus inclusifs.